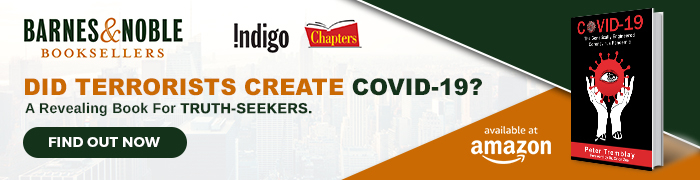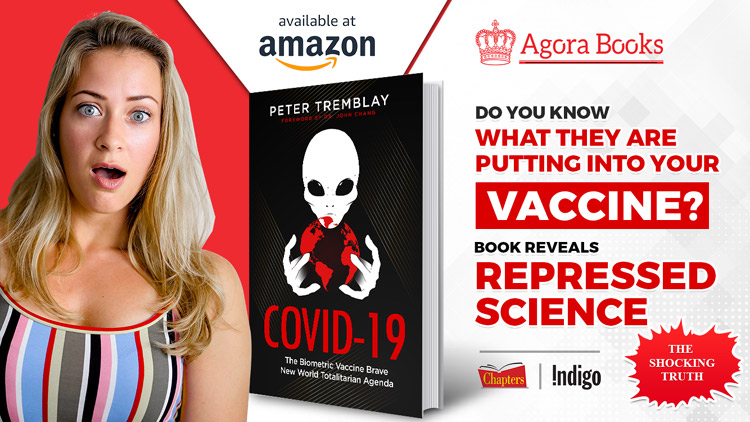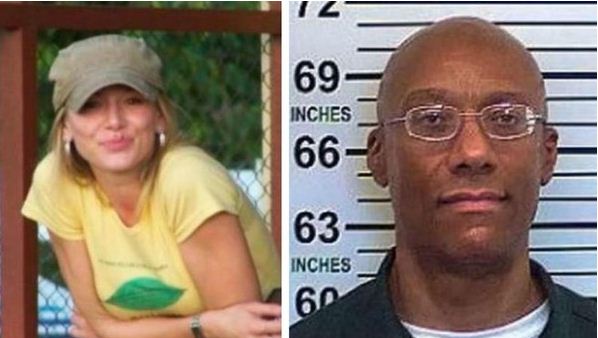Le patrimoine, parent pauvre de l’action gouvernementale

En pleine campagne électorale, le patrimoine sert de décor pour les discours, mais il est plutôt absent des engagements des partis.
Ce patrimoine bâti et paysager est une richesse collective qui nous distingue. C’est un actif pour le développement économique, social et culturel du Québec, de ses régions et de ses communautés, actif qui contribue fortement à l’attractivité du territoire.
Il reste pourtant fortement négligé et grevé d’une habitude de gestes à la pièce, sans vue d’ensemble. Même si le Québec ne publie pas d’état annuel de son patrimoine, de nombreux cas illustrent cette situation. Par exemple, à Montréal, la destruction du site archéologique du village des Tanneries dans Saint-Henri par le ministère des Transports, l’avenir incertain de l’Hôtel-Dieu ainsi que l’annonce du ministre de l’Éducation d’un projet de construction dans le jardin de la maison mère des Soeurs grises nonobstant son statut de site patrimonial protégé.
Les importants défis actuels commandent une action éclairée, coordonnée et dotée des moyens et de mécanismes de suivi conséquents. Il ne s’agit pas de mettre quelques sites sous verre. Pour le gouvernement, voilà autant d’occasions à saisir pour faire preuve d’innovation, d’engagement et de collaboration avec la société autant qu’avec les municipalités.
Or, le patrimoine reste un parent pauvre de l’action gouvernementale, que ce soit dans le dernier budget ou dans la politique culturelle dévoilée en juin 2018, celle-ci n’appliquant qu’une fraction des recommandations du rapport Courchesne-Corbo. Même la reconnaissance de sa protection comme principe de la loi québécoise du développement durable reste largement ignorée et sans effet tangible sur l’action du gouvernement.
On en parle bien lorsqu’il y a une menace ponctuelle à laquelle les responsables répondent par un geste in extremis ou en s’attristant de n’avoir pu agir à temps, promettant de faire mieux la prochaine fois. Mais, le grave manque d’entretien ou la désaffectation massive de nos bâtiments religieux ou institutionnels, la perte d’expertise ou encore l’insensibilité de la fiscalité et des investissements publics au patrimoine architectural et paysager ne pourront être résolus à la pièce.
Convaincu que l’on peut faire beaucoup mieux, Héritage Montréal rappelle aux futurs élus de l’Assemblée nationale et au prochain gouvernement du Québec les devoirs suivants :
Cohérence
Le gouvernement doit se doter d’une politique propre au patrimoine et aux paysages en lien avec des politiques nationales d’aménagement du territoire et d’architecture. Il faudra l’accompagner de ressources et de mécanismes crédibles de suivi et de concertation avec la société civile comme avec les municipalités et instances régionales pour en assurer le succès ; par exemple, la création d’un poste de commissaire qui fasse rapport de l’impact des investissements et des programmes sur l’état du patrimoine et sa viabilité.
Exemplarité
Le gouvernement doit établir un devoir d’exemplarité parmi ses ministères, organismes et sociétés d’État, ainsi que dans son budget. Dans le cas d’ensembles complexes en réaffectation comme l’Hôtel-Dieu ou l’hôpital Royal Victoria sur le mont Royal, cela comprend des processus de consultation et de concertation en amont avec la société civile pour trouver des pistes de solution pertinentes et rassembleuses. Il faut résoudre les cas d’écoles patrimoniales dégradées ou d’ensembles hospitaliers désaffectés.
Expertise
Le gouvernement doit reconnaître, valoriser et soutenir la formation et le développement de l’expertise en patrimoine — l’expertise professionnelle, les savoir-faire traditionnels, les connaissances citoyennes et la recherche scientifique — dans l’ensemble de son appareil, de son action et de ses projets, y compris en l’incluant, tout comme le talent, aux processus d’appel d’offres engageant les fonds publics.
Soutien
Le gouvernement doit aller de l’avant avec ses promesses de longue date et mettre enfin en place une fiscalité et des mesures incitatives pour l’entretien et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager, en accordant aux propriétaires privés ou communautaires des crédits d’impôt ou d’autres mesures de soutien financier. La valeur économique de tels investissements doit être reconnue et appréciée dans ses retombées multiples, économiques, touristiques comme sociales ou environnementales.
Métropole
Le gouvernement doit reconnaître l’échelle métropolitaine montréalaise dont les paysages bâtis, fluviaux ou ruraux, issus d’une géographie et d’une histoire exceptionnelles, donnent au territoire une très forte identité, et y soutenir la planification concertée. En 2012, cette concertation et une forte mobilisation a permis l’adoption par les élus de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) d’un premier Plan métropolitain d’aménagement et de développement pour lequel on définit actuellement les éléments d’un plan d’action propre aux enjeux de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysager. Le gouvernement doit soutenir ces efforts pour doter la métropole de programmes, de projets pilotes, de projets transitoires et d’outils, notamment fiscaux.
Héritage Montréal attendra du futur gouvernement comme de l’ensemble des élus de l’Assemblée nationale, et particulièrement ceux de la région de Montréal, un coup de barre majeur pour donner au patrimoine bâti et paysager l’attention qu’il mérite. Le temps où on s’y intéressait pour agrémenter de belles images, des documents autrement sans inspiration est révolu.